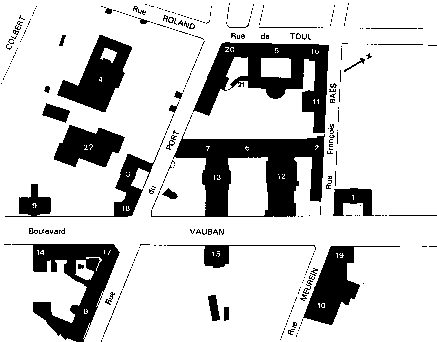Extrait de la revue "Ensemble"
De l'aventure initiale à l'expansion contemporaine :
La politique immobilière de l'Université
Jean-Pierre RIBA UT
(*) Frère Jean-Pierre Ribaut, vice-doyen de la Faculté libre des Lettres et Sciences
humaines, archiviste de la F-U-P-L-, en collaboration avec MM. Daniel Bourgois et Charles
Henin. La plupart des photos récentes sont dues à Mme Leprince-Ringuet.
retour à l'accueil
Au cours de l'année 1986, plusieurs faits insolites n'auront pas manqué d'attirer
l'attention du passant habitué à côtoyer les paisibles et immuables bâtiments de la
Catho.
Voir pointer une immense grue au beau milieu des immeubles de style néo-gothique
constitue un anachronisme qui en a surpris plus d'un : démolition ? construction ?... Il
a bien fallu se rendre à l'évidence ; dans l'étroit quadrilatère de l'Hôtel
académique le bâtiment de l'Institut Supérieur d'Agriculture prenait une nouvelle
extension. Aux premiers rayons du soleil printanier des grappes d'étudiants profitaient
du nouveau square, à l'angle du boulevard Vauban et de la rue Norbert Ségard, pour
attendre l'heure des cours ou rencontrer d'autres étudiants. Ces nouveautés qui
pouvaient susciter l'étonnement du passant ne surprenaient guère ceux qui franchissent
régulièrement le seuil du 60 boulevard Vauban ; depuis quelques années ils ont vu
progressivement changer des lieux auxquels une peinture grise uniforme avait valu une
solide réputation d'austérité.
En prenant un peu de recul, il est aisé de percevoir que, sur le plan immobilier, le
dynamisme de l'Université Catholique transparaît dans une campagne de rénovation et
d'extension sans égale depuis l'élan créateur qui, voici plus d'un siècle, permit
l'édification d'un ensemble cohérent et fonctionnel.
L'élan créateur
A partir de rien
Bien que préparée de longue date, la loi du 12 juillet 1875 qui accordait la liberté
de l'enseignement supérieur posa à ses promoteurs plus de problèmes qu'elle n'en
résolvait.
Certes, les Catholiques du Nord et du Pas-de-Calais, dans leur assemblée générale de
l'automne 1873, avaient pris la décision de créer une Université Catholique dès que
les conditions légales le permettraient.
A Lille, où l'on n'avait pas attendu le vote de la loi pour ouvrir des cours de droit,
dés l'automne de 1874, une situation provisoire fut rapidement mise en place. On demanda
aux Dames du Sacré-Coeur, qui venaient d'en faire l'acquisition, l'ancien hôtel de la
Préfecture pour y établir les Facultés de Droit et de Lettres ainsi que le Collège
théologique ; les Facultés de Médecine et de Sciences trouvaient refuge à proximité.
Le bail conclu prenait fin en mars 1881, date à laquelle les religieuses, déjà
propriétaires de l'immeuble contigu de la rue Royale, souhaitaient en disposer pour
agrandir leur maison (acquis ensuite par le diocèse, l'édifice deviendra, en 1908, le
pied à terre lillois des archevêques de Cambrai, puis le siège du nouvel évêché lors
de la création du diocèse de Lille en 1913).
Du côté de l'Université, on avait donc six ans devant soi pour édifier un ensemble
dont on ne possédait aucun plan, mais des idées générales très vagues, qui se
révéleront bientôt idéalistes et mal adaptées ; si l'on jetait son dévolu sur le
nouveau quartier Vauban, à l'Ouest de la ville, pour y bâtir les futurs locaux, aucun
terrain n'était encore acquis et l'on ne possédait d'ailleurs pas le premier franc
nécessaire à cette gigantesque entreprise.
retour à l'accueil
L'acquisition des terrains
Le rattachement à la ville de Lille, en 1858, de la commune rurale d'Esquermes et du
faubourg de la Barre, devait permettre à l'antique "insula" resserrée dans les
bras de la Deûle de se développer vers l'Ouest. C'est ce nouveau quartier qui est choisi
pour y implanter l'Université Catholique (les partisans de l'implantation de
l'Université dans les villes de Douai et d'Arras proposaient de l'installer dans des
bâtiments déjà existants, tel le palais Saint-Waast à Arras).
Des terrains vagues sont acquis à partir de 1877 au prix moyen de 20 francs le m2.
Deux ensembles contigus de part et d'autre de la rue du Port sont immédiatement
constitués :
l'îlot principal, de deux hectares, forme un quadrilatère bordé par le boulevard
Vauban, la rue du Port, la rue de Toul et la rue François Baës ; un second ensemble,
d'une superficie à peine moindre, s'étend de la rue du Port à la rue Colbert. Diverses
acquisitions plus ponctuelles portent à , cinq hectares et demi la superficie des
terrains de l'Université dans ce seul quartier. Acquis dans sa majeure partie en mai-juin
1877, ce domaine foncier est définitivement délimité en 1878, après des échanges de
terrains.
L'élaboration d'un ensemble cohérent
Avant même la fondation de l'Université, le futur recteur, le chanoine Édouard
Hauteur (1830-1915) avait effectué un voyage en Allemagne, étudié avec minutie les
installations des Universités étrangères, et même celles des Universités françaises.
Balayées par la Révolution, les Universités anciennes, auxquelles aimaient se
référer les Universités Catholiques nées de la loi de 1875, ne pouvaient servir de
référence architecturale pour l'ensemble à construire. Les conditions de l'enseignement
ayant été profondément modifiées et le projet des fondateurs de l'Université
Catholique de Lille apparaissant comme particulièrement ambitieux, aucun édifice
existant n'était capable de les inspirer.
Dans l'esprit du recteur, historien du Moyen Âge, la nouvelle Université Catholique
de Lille ne pouvait se concevoir que sur le modèle des prestigieuses institutions
médiévales, en particulier l'antique Collège Saint-Pierre établi à l'ombre de la
Collégiale lilloise. Dans cette optique, on décida d'édifier les bâtiments dans le
style gothique de la première moitié du XIIIe siècle, "qui, par son caractère
chrétien, par sa noble et belle simplicité se trouve merveilleusement en harmonie avec
la destination de l'édifice". Ce choix, tout à fait en accord avec les orientations
du temps, ne facilitait pas la tâche des maîtres d'oeuvre, l'architecture gothique
n'ayant pas laissé beaucoup de réalisations dans le domaine civil (la majeure partie des
édifices religieux construits à Lille dans la seconde moitié du XIXe siècle appartient
au style néogothique, à commencer par Notre-Dame de la Treille qui s'inspire également
de la première moitié du XIIIe siècle. L'architecture civile s'oriente au contraire
vers le néoclassique : Facultés de l'État, gare du chemin de fer, et même Collège des
jésuites, rue Solférino).
Les architectes successifs, le baron Béthune d'Ydewalle et Dutouquet, en collaboration
étroite avec le recteur Mgr Hautcoeur, dressent les plans d'un ensemble vaste et
original. En fonction du temps imparti, il importait d'agir sans délai. Une consultation
des doyens en mars 1877 permit au recteur de présenter un premier projet dès le mois
suivant.
---
Ardent défenseur de la Renaissance gothique en Belgique, le baron Jean-Baptiste
Béthune d'Ydewalle il 821-1894) était à la fois peintre, sculpteur et architecte. Sa
compétence technique suscitait la méfiance de ses collègues qui le considéraient
volontiers comme un "homme romanesque", alors qu'il s'efforçait, au-delà de la
seule architecture des bâtiments, de concevoir la décoration et le mobilier en harmonie
avec la construction. Ses plans pour le Sacré-Coeur de Montmartre ne furent pas retenus.
Louis Dutouquet (1821-1903), élève des Écoles académiques de Valenciennes, puis de
l'École des Beaux-Arts de Paris, s'installe à Valenciennes à partir de 1848. Mgr
Hautcoeur le fait choisir, en 1879, comme architecte du nouveau Carmel de Lille, proche de
l'Université et construit dans le même style.
Par suite de l'expulsion des carmélites, au début du siècle, ce bâtiment,
transformé en établissement scolaire, accueillera l'Institution Blanche de Castille,
puis Thérèse d'Avila.
retour à l'accueil
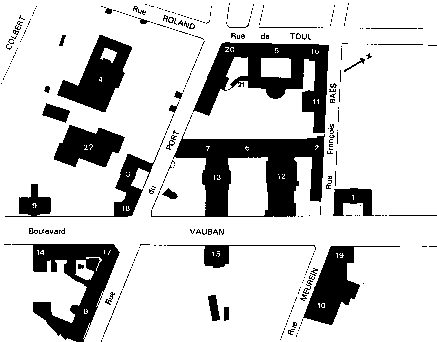 |
IMPLANTATION SUCCESSIVE DES BATIMENTS DE L'UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE
AU CENTRE DU QUARTIER VAUBAN 1. Maison de famille Albert le Grand 1879-1880.
2. Partie Nord-Est du Palais académique cl Bibliothèque 1879-1880.
3. Maison de famille Saint-Louis 1880-1881.
4. Faculté de Médecine 1882-1883.
5. Faculté des Sciences 1883-1884.
6. Partie centrale du Palais académique 1883-1885.
7. Faculté de Théologie 1885-1887.
8. Clinique Saint-Raphaël 1886-1889.
9. Maison de famille Saint-Michel 1892-1893.
10, Maison des étudiants 1900.
1l. École d'Électricité 1913.
12. Aula maxima.
13. Église universitaire.
14. Maternité Sainte-Anne 1925, devenue Foyer sacerdotal 1977.
15. Immeuble du 67 Boulevard Vauban _qui a abrité l'E.M.A.C.A.S., l'E.D.H.E.C., l'École
Supérieure de Journalisme et actuellement l'I.E.S.E.G.
16. I.S.E.N, 1960.
17. École d'lnfirmières et Puéricultrices 1962.
18. École de Service Social 1965.
19. Restaurant universitaire et Résidence Teilhard de Chardin 1966.
20. I.S.A. 1967-1968.
21. Laboratoire de magnétisme 1975.
22. E-D-H-E-C- 1976. |
Le baron Béthune proposera successivement trois séries de plans, chaque fois remis en
chantier pour manque de réalisme ; le refus du troisième projet établi en février
1879, mit fin en avril à la collaboration avec l'architecte belge. Durant l'hiver
1878-1879 des tractations avec le Valenciennois Dutouquet amenèrent à lui confier la
responsabilité des plans définitifs qu'il présente en juillet 1879.
Dutouquet se limite à remanier les plans précédents selon les vues des responsables
de l'Université. La conception générale, celle du baron Béthune, n'était pas remise
en cause. Le projet, grandiose, comportait essentiellement la construction de trois vastes
immeubles. L'édifice principal, dénommé "Palais académique", s'adjoint une
aile, destinée à abriter bibliothèque et observatoire, et se complète par deux
bâtiments accolés : l'église et l'aula maxima. La Faculté des Sciences et l'École des
Hautes Études Industrielles s'établissent dans un quadrilatère dont l'entrée se situe
rue de Toul. La Faculté de Médecine, séparée de l'îlot principal par la rue du Port,
s'élève au milieu d'un jardin botanique rattaché à la Faculté des Sciences. D'autres
constructions de moindre importance, maisons de famille, c'est-à-dire résidences
d'étudiants, cliniques et services hospitaliers, sont prévues dans le même quartier.
Une réalisation échelonnée
Un projet aussi ambitieux ne pouvait être mis en oeuvre sans d'importants moyens
financiers : née d'une initiative privée et portée par la volonté des Catholiques du
Nord et du Pas-de-Calais, cette Université dépendait entièrement de leur générosité.
Une souscription permit de recueillir, de 1875 à 1878, six millions et demi de francs 6
destinés non seulement à l'achat des terrains et à l'édification des bâtiments, mais
aussi à la fondation des chaires d'enseignement (cf. le volume Souscription pour la
fondation de l'Université Catholique de Lille, Lille, 1878, qui donne en détail une
récapitulation complète des sommes recueillies. La nouvelle souscription, ouverte en
1883, dépassait les 2.225.000 francs en septembre 1886...).
L'importance des constructions projetées, les contraintes de l'entrepreneur Rouzé, de
Lille, les diverses échéances des implantations provisoires, sans compter les limites
financières, imposèrent une réalisation échelonnée en plusieurs campagnes, ce qui
n'était pas prévu au départ. Cinquante années seront finalement nécessaires pour
achever entièrement le programme primitif, car des événements extérieurs à la vie de
l'Université interviendront pour retarder l'exécution d'un plan qui, dans l'esprit de
ses promoteurs, devait être réalisé en une dizaine d'années.
Philibert Vrau (1829-1905), industrieL1illois, fut avec son beau frère Camille
Féron-Vrau (1831-1908) parmi les plus ardents promoteurs de l'Université Catholique.
retour à l'accueil
Curieusement, le premier édifice mis en chantier fut l'actuelle Résidence Albert le
Grand, alors dénommée "Maison de famille Notre-Dame". Philibert Vrau 7, qui
fut à l'origine de cette initiative, lui assignait pour but de protéger des dangers de
la ville les étudiants étrangers à l'agglomération lilloise. La pose de la première
pierre eut lieu le 20 juin 1879, en la fête du Sacré-Coeur ; à peine achevés, les
bâtiments accueillirent au cours de l'hiver 1880-1881 les élèves du Collège
Saint-Joseph, fermé par suite de l'expulsion des Pères jésuites. Les 28, 29 et 30 juin
1881 s'y tint le Premier Congrès Eucharistique International. Enfin, les services
généraux de l'Université s'y installèrent en attendant de rejoindre le bâtiment
principal.
Commencé à l'automne de 1879, avec la pose solennelle de la première pierre le 22
novembre à l'occasion du Congrès annuel des Catholiques du Nord et du Pas-de-Calais, le
gros oeuvre de la première partie du Palais académique est achevé au printemps de 1881.
La partie Nord-Est de l'édifice et la bibliothèque qui en forme l'aile sont mises en
service l'année suivante. En 1880-1881 est bâtie la Maison de famille Saint-Louis ; la
faculté de Médecine sort de terre en 1882-1883.
Novembre 1882 marque un premier, mais bref arrêt que souligne Mgr Hautcoeur dans son
rapport de rentrée (Bulletin de l'Œuvre des Facultés Catholiques de Lille, 5e
année, nov. 1882, p. 33). Très vite, le programme se poursuit à un rythme soutenu :
l'édification du quadrilatère de la. Faculté des Sciences en 1883-1884, la partie
centrale de l'Hôtel académique de 1883 à l885. Le recteur note avec satisfaction lors
de la Séance solennelle de rentrée, le 19 novembre 1885 : "Toutes les facultés ont
abandonné leurs locaux provisoires". Rappelant le projet des deux bâtiments où
devaient trouver place l'aula maxima et l'église universitaire, il précise : "Tout
cela se fera en son temps. Nous l'attendons sans impatience. Au besoin les constructions
actuelles seraient suffisantes pendant une longue période" (ibid., 8e année, déc.
1885, pp. 39-40).
Les premières difficultés apparaissent, tempèrent l'enthousiasme des débuts et ont
un retentissement indirect au niveau de la politique immobilière. Ces difficultés ne
sont pas seulement d'ordre économique ; la loi Ferry de mars 1880 a supprimé les jurys
mixtes et retiré aux établissements libres le droit de porter le titre d'université. Le
conflit avec les Hospices de Lille au sujet de la jouissance de l'aile droite de
l'Hôpital de la Charité entrave le développement de la Faculté de Médecine. Bientôt
le siège de l'Académie et les Facultés de Droit et de Lettres quitteront Douai pour
Lille... sans parler des tensions internes qui amèneront un changement de recteur en
1888.
Cependant en 1886-l887, puis en 1888-1889, on édifie la Clinique Saint-Raphaël. Cette
première grande campagne s'achève, en 1892-1893, avec la construction de la Maison de
famille Saint-Michel.
Le ralentissement de la souscription, la stagnation du nombre des étudiants, puis la
Première Guerre mondiale retarderont l'achèvement du plan primitif. En 1900, s'élève
cependant la Maison des Étudiants, tandis que le secteur scientifique témoigne de son
extension avec la création de l'École d'Électricité des Hautes Études Industrielles
dont le bâtiment porte la date de 1913.
Bien qu'inachevé, l'ensemble réalisé entre 1878 et 1885, suscite l'admiration ; le
caractère résolument original de chaque bâtiment n'altère pas l'unité profonde
engendrée par le choix du style (Marie-Joseph Lussien-Maisonneuve a présenté une étude
architecturale des bâtiments dans "Fascination médiévale et architecture de la
Catho", Ensemble, 1977, pp. 277-289).
L'historien Lavisse, sensible à cette impression d'unité qui se dégage d'un tel
ensemble architectural, ne cache pas son admiration (Revue internationale de
l'enseignement, 15 décembre 1886, pp. 473-493). "Vous avez érigé, disait déjà en
novembre 1882 aux catholiques de la province ecclésiastique de Cambrai Mgr Cartuyvels,
vice-recteur de l'Université Catholique de Louvain, vous avez érigé, avec une
magnificence royale, le palais de la science chrétienne, et l'oeil de l'étranger, comme
celui de l'adversaire, s'arrête étonné devant ces édifices et se demande en vue de
quel grand dessein des mains privées ont pu dresser un monument pareil... Quand je
compare ce qui s'est fait ici, non par les efforts successifs d'un demi-siècle, comme
chez nous, avec l'appui de la nation entière, mais en cinq ans, à une époque de
bouleversements politiques.., quand je vois votre oeuvre debout, malgré tant d'oeuvres
que vous avez à soutenir, malgré les manifestations de l'anarchie, les destructions du
présent, les craintes de l'avenir ; quand, malgré tout cela, je vois que vous ne laissez
pas d'assurer avec un calme surhumain les destinées de cette grande oeuvre, je ne puis
m'empêcher, Messieurs, d'exprimer devant vous l'admiration qu'inspire au monde entier la
persévérance de chrétiens 'aussi éprouvés" (Bulletin de l'Œuvre des
Facultés Catholiques de Lille, 5e année, mai 1883, pp. 204-205).
.
Achèvement du plan primitif et constructions isolées
Dans l'esprit des fondateurs de l'Université, l'effort déployé dans le domaine
immobilier comportait un terme naturel : l'achèvement rapide des travaux entrepris. Mgr
Hautcoeur et les membres du Conseil d'administration, emportés par l'enthousiasme des
débuts, pensaient que dix innées suffiraient pour mener à terme le projet initial. Le
rythme imprimé aux premières constructions, durant les cinq années 1879-1884, laissait
bien augurer de la suite.
La Première Guerre mondiale retarda l'exécution des deux derniers éléments du plan
dressé en 1877 : l'église universitaire et l'aula maxima. En vue de la célébration du
cinquantenaire14 de l'Université, l'achèvement du premier programme constitua un
objectif prioritaire (ouvert en novembre 1874 avec la création des premiers cours de
Droit, l'Institut Catholique de Lille fut inauguré un an plus tard. L'inauguration
solennelle de l'Université Catholique de Lille eut lieu en janvier 1877 dés réception
des Lettres Apostoliques qui l'érigeaient en Université pontificale. Cette dernière
date fut retenue comme véritable point de départ pour toutes les cérémonies
jubilaires). C'est ainsi que l'architecte J.-B. Maillard fit édifier les deux bâtiments
qui relient l'Hôtel académique au boulevard Vauban : l'église et l aile Vauban.
La différence entre les périodes de construction et l'influence de l'architecte
apparaissent nettement quand on compare le style des bâtiments. Le néogothique élégant
de Dutouquet s'accommode mal de celui plus lourd et massif de Maillard.
Avant même que soit achevé le projet initial, de nouveaux besoins devaient
déterminer une nouvelle ère de politique immobilière. Le 19 novembre 1925, on
inaugurait solennellement, 87 boulevard Vauban, la nouvelle Maternité Sainte-Anne. Elle
se rapprochait de la Clinique Saint-Raphaël où elle avait été fondée en 1877 avant
d'émigrer vers l'Hôpital de la Charité, et de s'établir rue du Marché dans le
quartier de Wazemmes.
Avec la Maternité Sainte-Anne débute une série de constructions isolées répondant
à des besoins ponctuels. Le secteur médical, et plus particulièrement hospitalier, se
trouve concerné dans un premier temps, puisqu'après la Maternité Sainte-Anne, c'est la
Polyclinique saint- Philibert qui sort de terre, en 1933 ; elle est inaugurée le 16
novembre par le Nonce Apostolique Mgr Maglione.
L'après-guerre voit l'institution affrontée à d'autres problèmes. Après la
laborieuse remise en route d'un établissement que les premiers mois de la guerre avaient
décapité sans l'amener cependant à cesser son activité, des problèmes d'effectifs et
plus encore de diversification des enseignements détermineront des incidences
immobilières. L'École des Missionnaires du Travail, devenue en 1946 École des
Missionnaires d'Action Catholique et d'Action Sociale (E.M.A.C.A.S.) et l'E.D.H.E.C.
quittent la Faculté de Droit Dont elles sont issues pour s'installer temporairement dans
l'hôtel du 67 boulevard Vauban, avant d'immigrer l'une vers Mons-en-Baroeul, l'autre dans
des locaux neufs.
Le développement des Écoles d'ingénieurs va changer la figure de l'îlot principal.
Outre d'importants aménagements intérieurs, tels celui de l'amphi de Chimie divisé dans
sa hauteur, en 1963-1964, qui permet la création de salles supplémentaires, deux
constructions s'élèvent aux angles de la faculté des Sciences : celle de l'I.S.E.N, en
1960, celle de l'I.S.A, en 1967-l968. Si ces deux édifices arrivent encore, non sans mal,
à s'intégrer dans le style général des bâtiments, la réalisation dans le jardin
intérieur de l'Hôtel académique du laboratoire de magnétisme, en 1975, illustre la
prédominance de l'utilitaire à court terme sur une politique concertée dont cette
période intermédiaire des années 1955-l970 nous fournit divers exemples. Que dire alors
du souci de l'environnement et du cadre de vie ?
retour à l'accueil
Vers une politique immobilière cohérente et concertée
S'adapter aux temps
Une modification profonde de cette attitude empirique devenait nécessaire. Certes, le
manque d'entretien de certains bâtiments rendait urgentes des décisions capitales. La
création de la Fédération, en 1973, facilitait l'élaboration d'une politique
concertée, y compris sur le plan immobilier ; les fêtes du centenaire, en 1976-1977,
marquaient le départ d'une campagne de rénovation des bâtiments du 60 boulevard Vauban.
Un service de maintenance fut constitué ; au-delà de l'entretien et de l'aménagement
des locaux, sa mission est de prendre en charge la politique immobilière de la
Fédération en lien avec les établissements et instances concernés, notamment la
Commission immobilière.
Différents aspects de la réalité : démographique, économique, pédagogique...
imposèrent une meilleure exploitation des lieux existants et la recherche de nouveaux
locaux. Certes, on ne se trouvait plus devant la table rase des années 1875 qui
permettait une création pure. Sur le plan des décisions la situation s'était également
bien transformée. Au système monolithique et pyramidal où l'I.C.L., propriétaire,
décidait et payait, s'est substituée une réelle décentralisation, assortie de
l'autonomie. Les établissements fédérés ont l'initiative des projets dont l'exécution
reste subordonnée, suivant les cas de figure, à l'accord du propriétaire du terrain
(généralement l'Institut Catholique par l'intermédiaire de la Société Civile
Immobilière), à l'apport complémentaire de la F.U.P.L.
Le plus élémentaire réalisme impose de partir de ce qui existe et d'en tirer le
meilleur parti, toujours au moindre coût, en tenant compte des contraintes nouvelles et
du changement des conditions de vie. Au surplus, il faut, si possible, dépasser les
besoins immédiats pour faire des prévisions à moyen ou long terme. C'est dire qu'un
siècle plus tard, la problématique est toute différente et que l'élan créateur des
débuts cède la place à une politique de développement tout aussi dynamique.
Partir du réel
Les événements se chargent d'ailleurs d'imposer leurs contraintes. Le paramètre
déterminant dans la nouvelle campagne immobilière entreprise au sein de la Fédération
dans les années 70, réside dans l'augmentation des effectifs. Dès 1955, se fait sentir
la saturation de locaux conçus pour héberger deux ou trois mille personnes (les Archives
de l'Institut Catholique de Lille qui conservent, dans la série H-Constructions, une
documentation exhaustive sur le programme immobilier des années 1877-1890, ne gardent
aucune trace du nombre précis d'étudiants prévu dans l'élaboration d'un programme où
la surface et les volumes semblaient être accordés généreusement ; aussi les témoins
parlent volontiers de splendeur et de magnificence, et les adjectifs " vaste ",
"immense ", voire "luxueux ", arrivent tout naturellement sur leurs
lèvres).
Divers aménagements, en un premier temps, permirent d'y remédier. Ces dix dernières
années, le nombre des étudiants a doublé ; il approche aujourd'hui les dix mille, sans
compter les stagiaires de la formation permanente ou les auditeurs des cours publics et
activités culturelles, ce qui amène à un effectif total d'environ quinze mille
personnes fréquentant_ les locaux universitaires chaque semaine. A cette importante
évolution quantitative répond une exigence qualitative accrue qui trouve une
répercussion au niveau des locaux : aujourd'hui les immeubles sont bien plus que les murs
et les planchers, qui apparaissent à première vue ; ils sont bourrés d'équipements, de
réseaux, d'installations plus ou moins complexes.
Le besoin croissant et légitime d'affirmation d'identité des établissements pose de
sérieux problèmes de place. Souvent issues des cinq Facultés traditionnelles (Droit,
puis Sciences économiques, Sciences, Lettres, Médecine, Théologie), les Écoles
Supérieures tendent à prendre leur autonomie en s'installant dans des locaux propres,
voire dans des immeubles distincts de leur implantation d'origine. Pourtant une volonté
de vivre ensemble dans le même quartier permet en premier lieu de bénéficier des
équipements communs (Restaurant universitaire, Bibliothèque, Centre Universitaire de
Promotion de la Santé : avec ses quatre chaînes, le Restaurant universitaire de la Catho
sert prés de 5.000 repas chaque jour, soit quelque 800.000 dans l'année. La
Bibliothèque centrale de l'I.C.L. conserve prés de 500.000 volumes ; le C.U.P.S. vient
d'ouvrir ses portes, à l'automne de 1986, dans les nouveaux locaux du 42 boulevard
Vauban) mais plus encore, le côtoiement de divers modes de pensée contribue à
l'enrichissement de tous, dans une multidisciplinarité vécue au quotidien.
Aménager l'ancien
La recherche d'une solution passe en premier lieu par une meilleure utilisation des
immeubles existants avant qu'on envisage l'implantation dans de nouveaux locaux. L'Hôtel
académique fournit ainsi un bel exemple de gain de place avec l'aménagement des combles
en bureaux de chercheurs au cours des années 1985-1986 ; un résultat semblable fut
obtenu, en 1977, avec la transformation d'amphis dans le secteur scientifique ; la
création de plusieurs niveaux dans la chapelle absidale, en 1985, permit de créer des
surfaces neuves dont ont bénéficié la Faculté de Théologie, l'E.S.A.D. ou les Écoles
de langues (le signataire de ces lignes aurait mauvaise grâce à ne pas reconnaître que
ces travaux ont valu, en outre, au service des Archives centrales de l'I.C.L, une
extension appréciable de la superficie de ses magasins). On notera au passage, le souci
de respecter le style des lieux, dans cette dernière réalisation.
Pour intéressante qu'elle soit, cette solution reste très limitée, les murs des
anciens bâtiments n'étant pas encore extensibles ! La transformation d'immeubles,
souvent facilitée par le changement de destination, offre une possibilité de meilleure
répartition des surfaces et d'aménagements plus fonctionnels. Ainsi l'Hôtel particulier
du 67 boulevard Vauban qui hébergea successivement l'E.M.A.C.A.S. et l'E.D.H.E.C., puis
l'École de Journalisme, fit, en 1981, l'objet d'une complète rénovation, au bénéfice
de l'I.E.S.E.G., tout comme la maison de la rue Patou occupée par l'École de Formation
d'Animateurs Sociaux.
L'amélioration du cadre de vie peut susciter des travaux de restauration dignes
d'être soulignés : ainsi le ravalement des façades à la Clinique Saint-Raphaël, rue
du Port, ou à la Faculté des Sciences, rue de Toul. Sur le boulevard Vauban,
l'aménagement de deux jardins aux extrémités de l'îlot principal a permis, en faisant
disparaître deux verrues, de mieux rendre perceptible l'unité architecturale.
retour à l'accueil
Chercher de nouvelles implantations...
Parallèlement à cette rénovation du patrimoine immobilier de l'Université, une
extension de ce même patrimoine s'avère de plus en plus urgente pour répondre aux
besoins les plus pressants.
Quand la configuration des lieux le permet, cette extension peut être obtenue par des
constructions adjacentes ; ainsi la Faculté de Médecine a pu édifier un nouveau corps
de bâtiment en 1980 et un nouvel amphi en 1986, poursuivant une volonté d'agrandissement
manifestée dès 1970-l972 par la séparation en deux niveaux de l'ancien amphi
Féron-Vrau pour en doubler la superficie utilitaire.
L'acquisition récente d'immeubles anciens situés dans le Quartier Vauban, suivie de
leur remise en état, apparaît comme une solution d'avenir. En 1985-1986, l'I.S.E.N, a pu
s'installer dans de nouveaux locaux cédés par le Centre Scolaire Saint-Paul, à l'angle
de la rue Solférino. Deux ministres ont présidé l'inauguration de cette nouvelle
installation, le jour même où le créateur de l'École, Norbert Ségard (1921-l980),
donnait son nom à l'ancienne rue François Baès. En cette même année 1986, l'achat de
deux maisons de maître, aux 40 et 42 boulevard Vauban, en face du nouvel I.S.E.N.,
permettait au C.U.P.S. et à l'I.F.A.C. de disposer d'espaces indépendants et mieux
adaptés à leur destination.
Signe de la volonté de regroupement des établissements dans ce secteur, cette
opération permettait surtout de ne pas laisser passer l'opportunité d'acquérir des
terrains construits ou constructibles dans le quartier.
Pourtant ces deux solutions restent souvent insuffisantes pour répondre aux besoins
les plus urgents ; il faut alors recourir aux constructions nouvelles. Elles ont été
nombreuses ces dernières années. A la suite de l'École d'infirmières et de
Puéricultrices ou de l'École de Service Social, l'École de Haute Études Commerciales,
d'abord installée dans la Résidence Teilhard de Chardin, a fait édifier de nouveaux
locaux dans le quadrilatère de Médecine en 1977 et s'apprête à y effectuer une seconde
tranche de travaux. L'Institut de Kinésithérapie - Podologie - Orthopédie s'est établi
dans l'enceinte de l'ancien Hôpital Saint-Philibert.
Reste toujours la possibilité d'acquérir, au-delà du secteur, des terrains à bâtir
pour construire de nouveaux édifices : c'est la solution retenue pour la création de
l'Hôpital Saint-Philibert, lors de son transfert à Lomme en 1976. Il était impensable
de trouver un terrain de plus de deux hectares et demi, en pleine ville, pour édifier un
complexe hospitalier neuf capable d'accueillir les services agrandis et surtout
modernisés de l'ancien Hôpital Saint-Philibert et de la Maternité Sainte-Anne. Une
opération identique permettra, à moyen terme, la création d'un nouvel Hôpital
Saint-Vincent, au sud de Lille, sur un terrain de plus de deux hectares. Des
délocalisations plus importantes sont parfois réalisées. En quittant Roubaix pour
s'installer à Villeneuve-d'Ascq, l'ancien Institut Technique Roubaisien est devenu
l'École Supérieure des Techniques Industrielles et des Textiles.
...en raison des contraintes et changements
Souvent tributaire de la nécessité, la politique immobilière l'est aussi du
changement, en particulier à cause des contraintes imposées par les événements ou les
règlements. Ainsi le premier choc pétrolier, en 1974, a entraîné l'isolation des
toitures de la majeure partie des immeubles anciens, voire, la pose de faux plafonds dans
des locaux où l'architecture du XIXe siècle avait dispensé le volume avec
générosité.
A côté de ces mesures destinées à favoriser les économie d'énergie, dans un
ensemble où les frais de chauffage comptent pour 15 % des charges de maintenance, des
normes de sécurité impératives imposent d'onéreuses transformations qu'accompagne
parfois une restauration importante, voire totale, de bâtiments anciens, comme ce fut le
cas à la Résidence Saint-Michel, en 1985. Mais le plus souvent, le simple souci
d'hygiène ou de confort appelle des rénovations comme celle qui, depuis 1980, s'efforce
de donner un visage plus accueillant à l'Hôtel académique.
Le renouvellement de la pédagogie, donnée primordiale dans un établissement
universitaire, influe directement sur la conception des locaux ; on pense tout
naturellement à l'aménagement des laboratoires du secteur scientifique ou des Écoles de
langues, sans prendre en compte les équipements de sonorisation, de projection ou de
vidéo, fixes ou mobiles, qui nécessitent des installations spécialisées.
L'informatique, indispensable auxiliaire de la recherche, prend une part grandissante
dans l'enseignement ; des centres informatiques performants, installés dans des locaux
adaptés et reliés à des ordinateurs intérieurs ou à des banques de données
extérieures, fonctionnent dans les secteurs scientifique ou économique, mais aussi à
l'École de Professeurs... De même, la bureautique envahit les secrétariats, où les
claviers de la dactylo cèdent le pas aux écrans et aux imprimantes. Ainsi, de nouveaux
types de locaux s'avèrent nécessaires dont la variété s'étend des serres du jardin
botanique à la nouvelle salle des sports Norbert Ségard, réalisée en 1978, en
collaboration avec le Centre Scolaire Saint-Paul.
Aussi importante que la modification de la pédagogie, et peut-être moins perceptible
tant elle imprègne notre vie quotidienne, galle des modes de vie entraîne des
changements profonds dont les bâtiments sont amenés à subir les répercussions. Loin
d'être résolu de façon satisfaisante (mais peut-il l'être dans un secteur aussi
urbanisé que le quartier Vauban ?), le problème du parking des véhicules reste une
préoccupation majeure. Bien que des centaines de places aient été dégagées au cours
des dernières années, se garer dans ce secteur relève parfois de l'exploit, alors que
le stationnement des voitures était encore relativement aisé, boulevard Vauban, il y a
vingt ans !
Autre signe des temps : si la première ligne de téléphone, installée à la Catho en
1923, a suffi, durant près de quarante ans, à répondre aux besoins, l'ensemble
universitaire comporte aujourd'hui plus de 1.500 postes dont les 3/4 sont branchés sur
des installations interconnectées : à eux seuls, ces chiffres font prendre conscience du
changement provoqué dans notre univers par le développement de la communication. Dans le
même ordre d'idées, un studio de radio, mieux vaudrait dire une "maison de la
radio", a été aménagé au sein de l'ensemble scientifique ; une radio-libre, Radio
Cité Vauban, gérée par des élèves-ingénieurs, émet dans le rayon de la métropole
lilloise, sur une fréquence de 91,3 MHz à raison de 120 heures par semaine.
L'attention portée à l'environnement constitue aujourd'hui une dimension importante
de la politique immobilière.
Établie sur une superficie d'environ six hectares dans le quartier Vauban, la Catho se
trouve souvent placée devant des choix délicats pour maintenir un équilibre entre les
surfaces construites et les espaces verts. L'indispensable multiplication des parkings
s'est faite au détriment des pelouses, bien qu'on ait essayé de respecter les arbres.
Mais la nécessité entraîne parfois une modification des points de vue...
L'utilisation de nouveaux matériaux, comme l'aluminium ou les matières plastiques
dans les menuiseries, l'inox et les ardoises artificielles dans les couvertures, demande
une attention particulière pour concilier, dans les efforts de rénovation, les
découvertes récentes et le caractère des lieux.
On retrouve, en fait, la préoccupation des bâtisseurs de 1880 qui surent allier la
tradition, incarnée par le style gothique, et la modernité, avec l'emploi du béton
armé, l'utilisation de charpentes métalliques et de voûtes de briques, pour séparer
les étages, ce qui permit de faire l'économie des contreforts saillants, dont certains
nostalgiques du passé auraient voulu "orner" les façades.
retour à l'accueil
Perspectives
'L'augmentation des effectifs a contraint l'Université Catholique de Lille à définir
une politique immobilière concertée. La transformation de la société et de
l'enseignement impose de prévoir l'avenir. Face au manque de place et à la limitation
des moyens, une utilisation plus intensive des locaux doit être envisagée ; l'année
universitaire s'allonge, des cours sont donnés le soir et le samedi. Parallèlement à
cette extension dans le temps, celle des espaces reste indispensable.
Une plus grande mobilité devient ainsi nécessaire, plusieurs fondations récentes
n'ont pu avoir lieu qu'à la suite de délocalisations : ouverture du Foyer international
de Jeunes Filles, rue de la Bassée, et de la Maison médicale Saint-Camille, rue Saint
Jean-Baptiste de la Salle, suite au départ, pour Lomme, de l'Hôpital Saint-Philibert ;
un Foyer sacerdotal à l'intention des prêtres enseignant à l'Université s'est
installé dans les locaux de l'ancienne Maternité Sainte-Anne ; la construction du nouvel
Hôpital Saint-Vincent rendra disponible pour un autre usage les 4.800 m2 de la Clinique
Saint-Raphaël. Des utilisations multiples peuvent être envisagées ; l'église
universitaire, qui accueille toujours les grandes célébrations liturgiques ou
para-liturgiques, sert également de salle d'examens, tandis que trois chapelles de
dimensions plus modestes, répondent aux besoins quotidiens du culte. Le monde de demain
oblige à "s'adapter à l'adaptabilité", ou plus modestement au changement :
les grands immeubles tendent à être en situation de remembrement permanent; certaines
salles de cours sont successivement devenues en dix ans, salle vidéo, puis salle
d'ordinateurs, avant d'être finalement transformées en bureau par suite de
réorganisation interne d'un établissement.
Le coût de la construction ou de la rénovation, les contraintes de rentabilité, les
allures de "bourse immobilière" qui prévalent de plus en plus dans les
discussions obligent à une concertation des différents éléments de l'ensemble
universitaire pour une politique immobilière globale : l'aide de la Fédération aux
réalisations particulières est d'ailleurs subordonnée à cette clause, car il ne suffit
pas de , gérer le présent ou l'avenir à court terme ; une politique responsable
s'efforce de préparer l'Université de demain.
Le projet est ambitieux : il faut, en premier lieu, augmenter notablement, doubler dans
certains cas, les surfaces pour atteindre les normes officielles. Une telle extension
suppose un effort de prospective et un financement approprié : la campagne de
souscription 1986-1987 insiste sur cet aspect des besoins urgents de l'Université qui
doit acquérir encore, soit de nouveaux terrains, soit d'anciens immeubles, dans le
quartier Vauban.
Les prévisions à plus long terme, à partir des prospections de courbes d'effectifs,
imposent de n'écarter aucune des hypothèses qui auraient chance de résoudre le
problème grave du manque d'espace. Il est certain, pour se limiter à un seul exemple,
que de très importants investissements sont à envisager pour doter le quartier des
infrastructures indispensables à un "campus universitaire" implanté en milieu
urbain. L'imagination et l'esprit d'entreprise seront demain, comme hier, aussi
nécessaires que les moyens financiers.
Les responsables de la politique immobilière de l'Université Catholique de Lille sont
aujourd'hui affrontés à des problèmes qui les apparentent aux aventuriers qui, voici un
siècle, ont réussi à faire sortir de terre, en quinze ans, un gigantesque ensemble dont
il était audacieux d'imaginer l'aussi rapide réalisation. Puissent-ils, avec le même
enthousiasme et la même foi, se montrer, dans des conditions bien différentes mais
certes pas plus aisées, les fidèles continuateurs de leur oeuvre !
retour à l'accueil
URL : http://www.chez.com/jroch/catho/catho.htm
Conception et mises à jour : jroch@chez.com |
Dernière mise à jour le 19/11/98
|